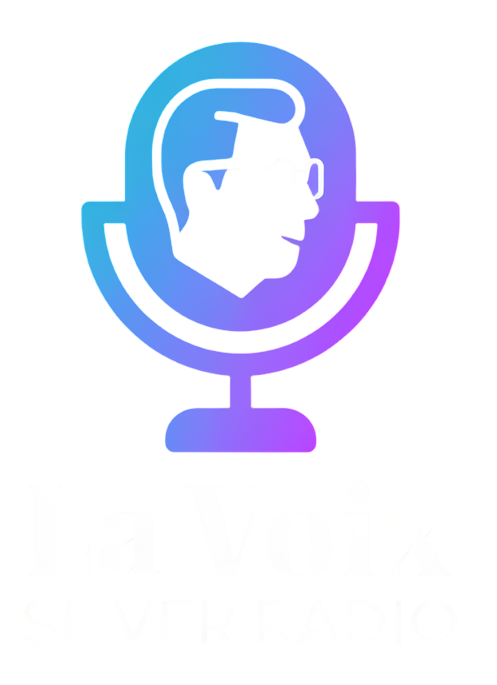Le rôle des seniors dans la vie politique et publique : influence et engagement
Quand il s'agit d’exercer leur droit de vote, les seniors donnent souvent l’exemple. Selon une étude de l’INSEE, le taux de participation des plus de 60 ans est systématiquement supérieur à celui des plus jeunes tranches d...