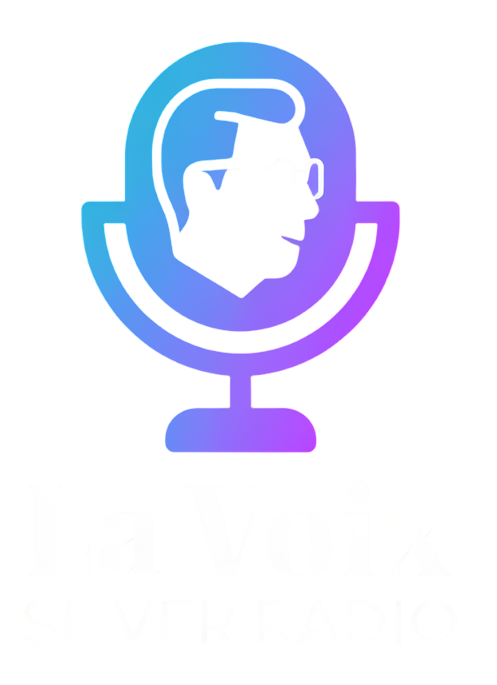Quel rôle joue vraiment le vote des seniors dans les élections présidentielles ?
Selon l’Insee, en 2022, près de 20 millions de Français avaient plus de 60 ans, soit pratiquement un tiers de la population totale. Cette part de la population ne cesse de croître, sous l’effet du vieillissement gén...